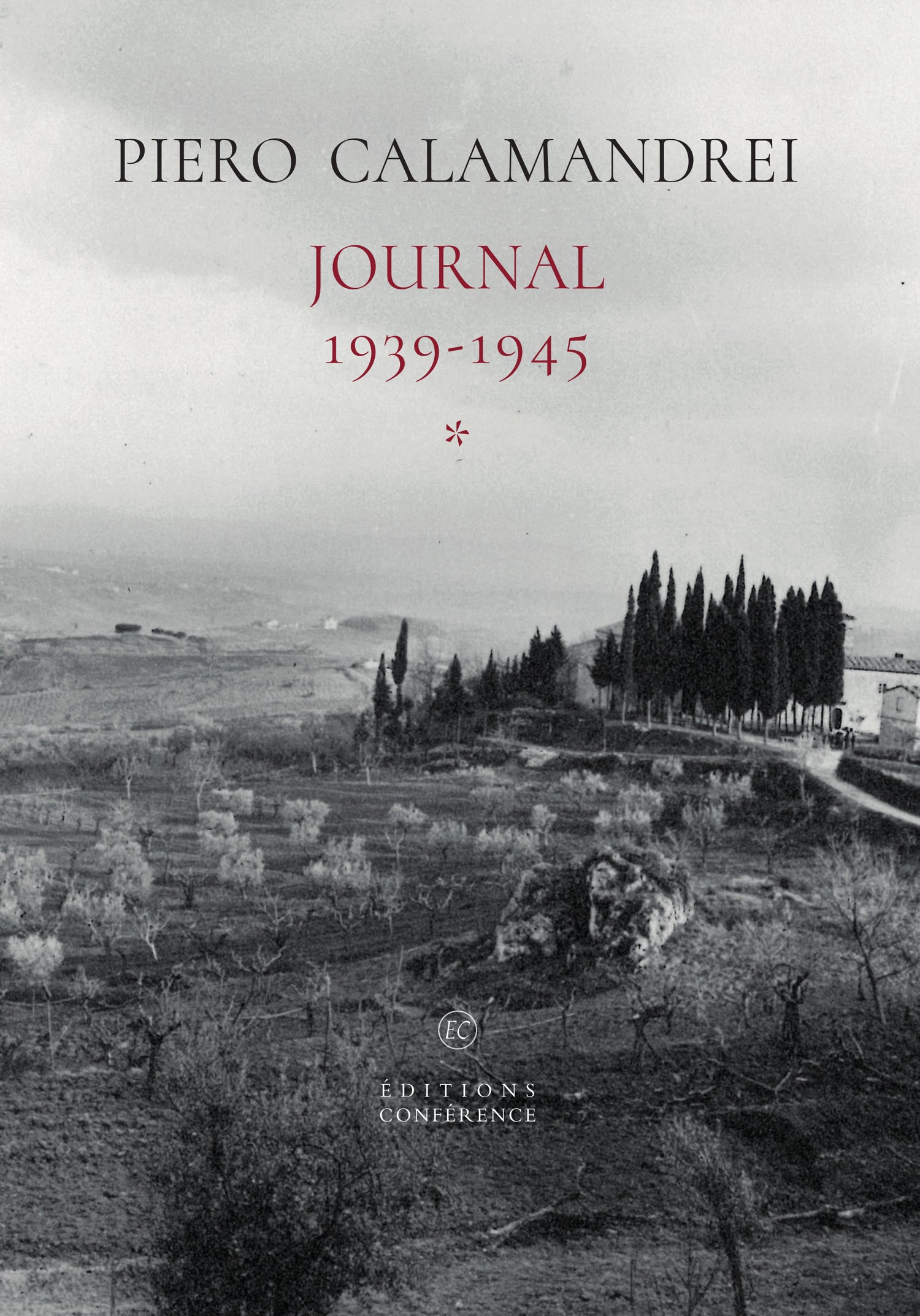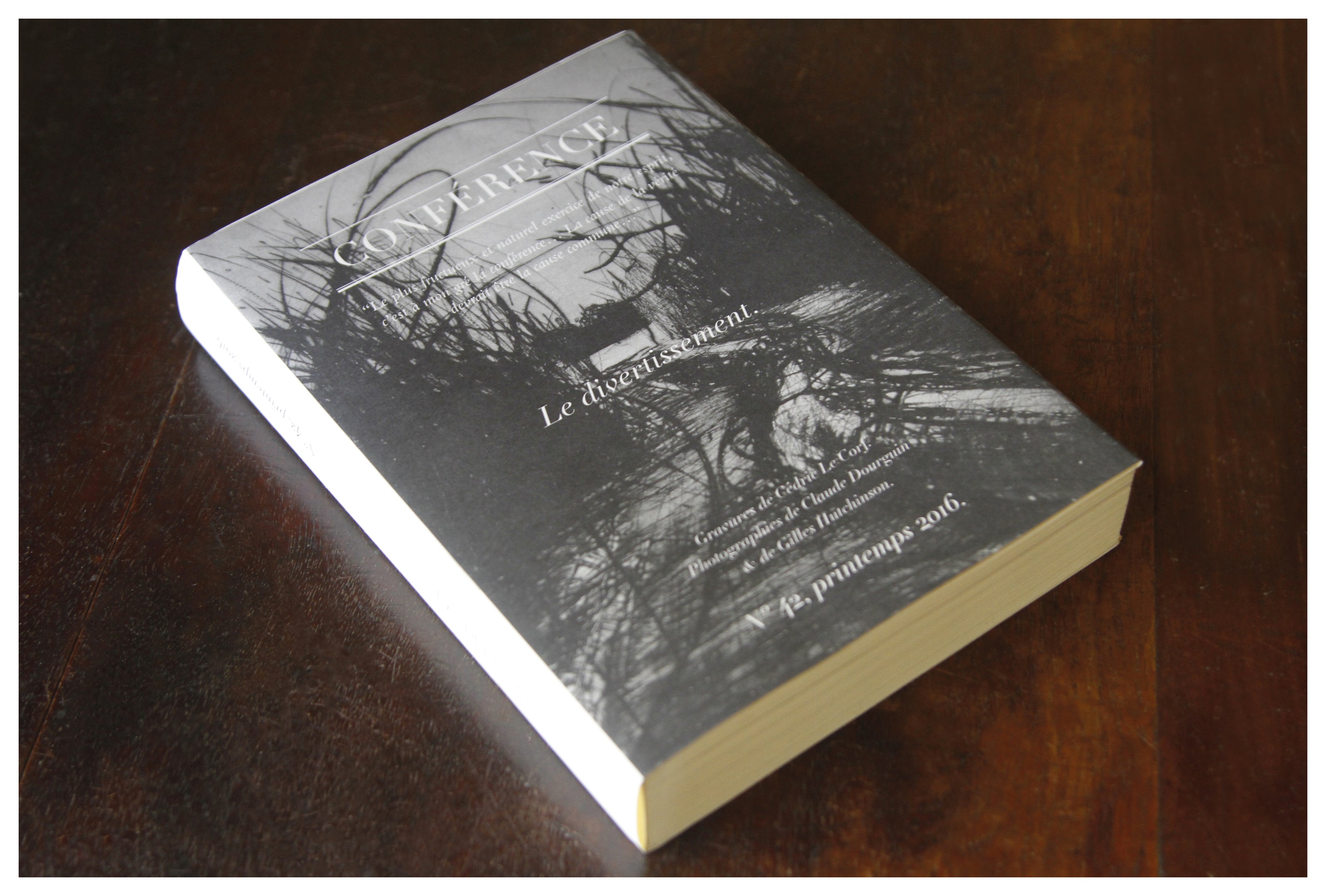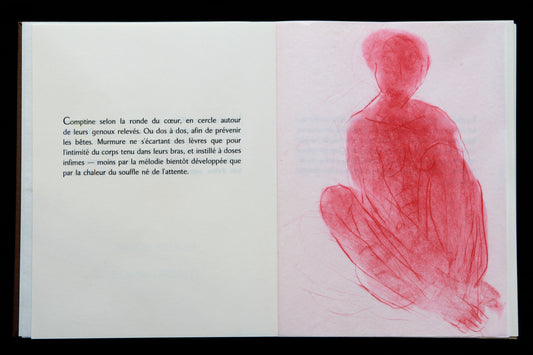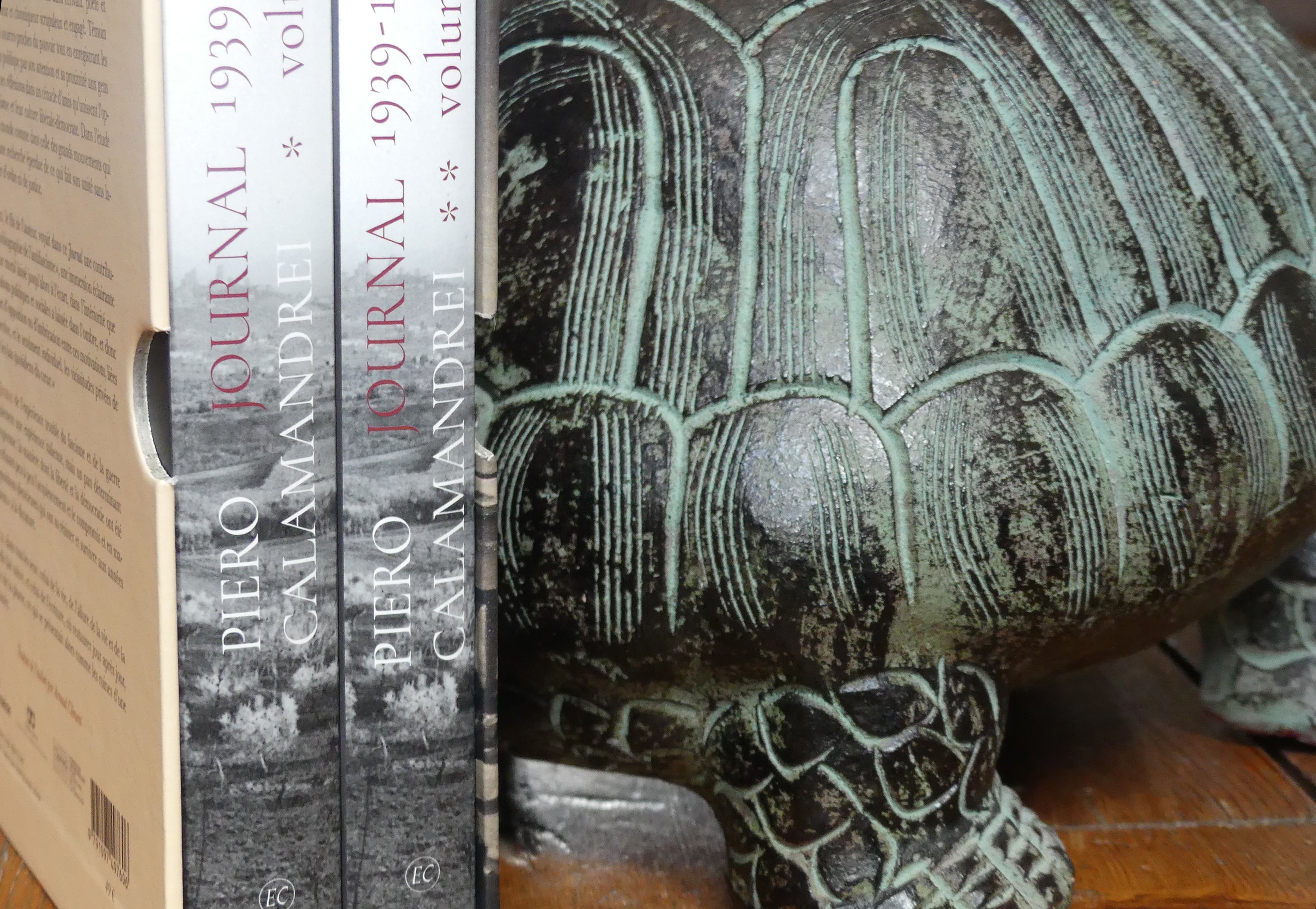

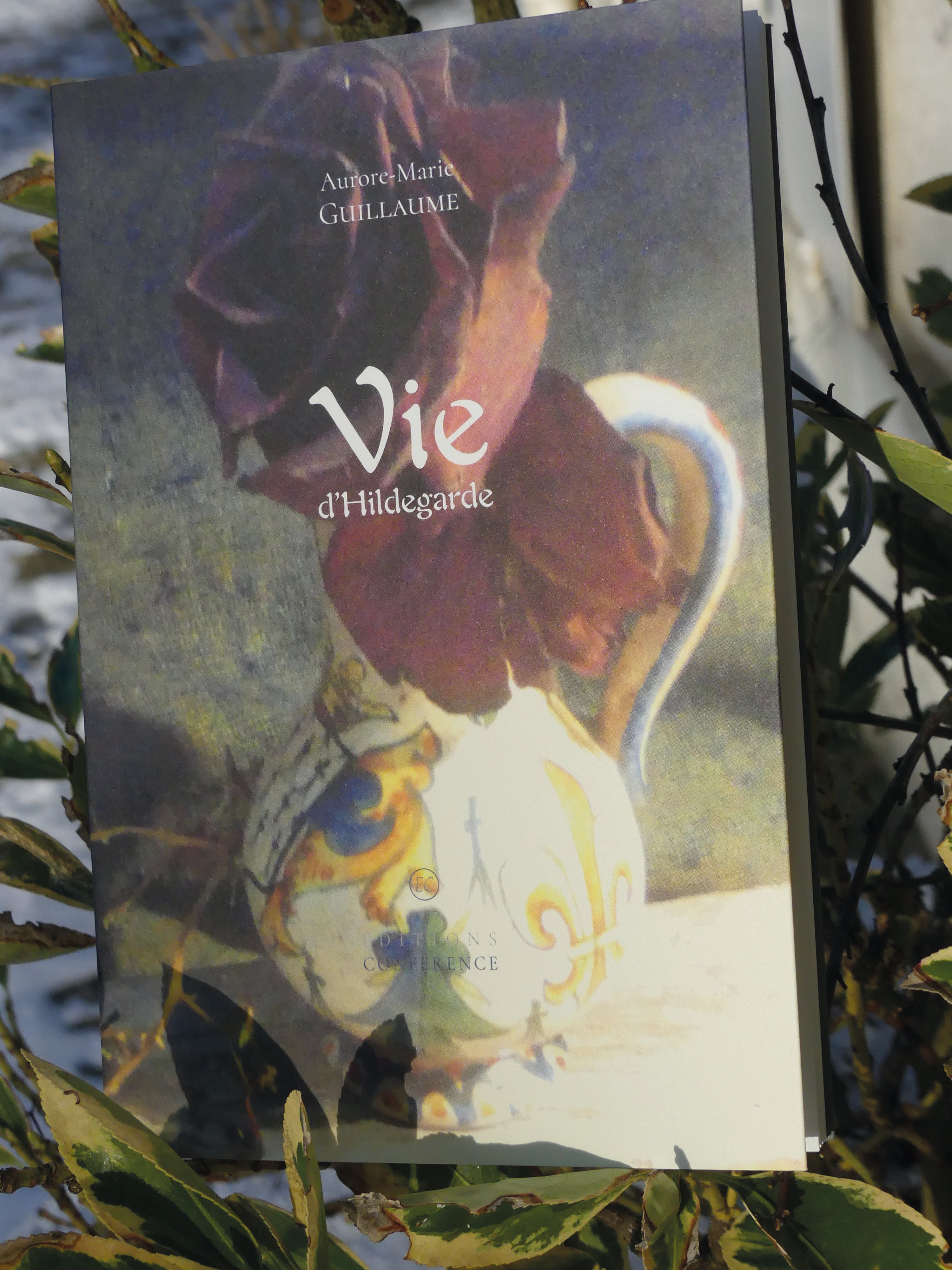


Depuis 30 ans, Conférence fait redécouvrir des œuvres importantes parfois oubliées, ou simplement méconnues en France, et promeut des œuvres nouvelles ou jamais traduites jusqu’alors.
Actualités
-
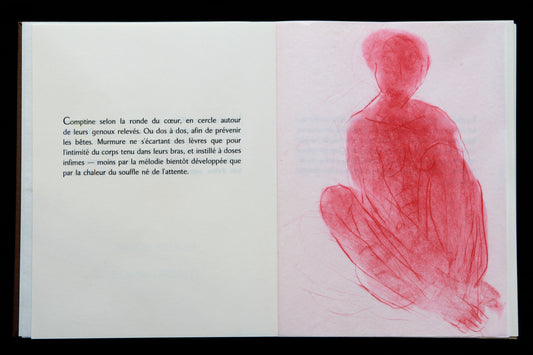
Décès de Claude Garache, peintre et graveur
Le peintre et graveur Claude Garache, avec lequel Conférence a réalisé de nombreux ouvrages, s'est éteint le 5 septembre dernier. Alain Madeleine-Perdrillat nous rappelle quelques éléments de son parcours.
Décès de Claude Garache, peintre et graveur
Le peintre et graveur Claude Garache, avec lequel Conférence a réalisé de nombreux ouvrages, s'est éteint le 5 septembre dernier. Alain Madeleine-Perdrillat nous rappelle quelques éléments de son parcours.
-

Assunta Genovesio à la Galerie PRODROMUS
Exposition du 15 septembre au 12 novembre 2023 à l'occasion de la parution du livre Assunta Genovesio. Tendresse de l'espace. aux Éditions Conférence.
Assunta Genovesio à la Galerie PRODROMUS
Exposition du 15 septembre au 12 novembre 2023 à l'occasion de la parution du livre Assunta Genovesio. Tendresse de l'espace. aux Éditions Conférence.